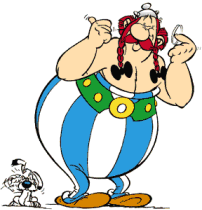« La religion relève de l'intime, l'Eglise n'a pas à intervenir sur des questions de loi », lançait Anne Hidalgo, 1ère adjointe au maire de Paris, lors de l'émission Mots-croisés du 17 septembre dernier. Le débat du soir portait sur le mariage gay et l'homoparentalité. Quelques semaines plus tôt, c'est l'ex-ministre sarkozienne Roseline Bachelot qui s’irritait de l’immixtion de l’Eglise en la matière : « il est bien entendu légitime que les religions émettent des préconisations, mais dans une république laïque, celles-ci ne peuvent constituer une référence (…). Il convient donc de laisser les religions dans la sphère privée » (1). Paf,
la messe est dite. Sans souffrir d’appel, la sentence revient chaque fois que
l'Eglise ouvre la bouche, ses interventions étant de facto taxée d’illégitimité dès lors qu’elle ne se cantonne pas
aux burettes et encensoirs. C’est à s'étonner qu'on ait pu lui reprocher
certains silences en d’autres temps...
mardi 18 septembre 2012
mercredi 5 septembre 2012
Calcutta ou la soif de Dieu
Le 5 septembre 1997, dans sa petite cellule de Calcutta, celle connue dans toute l’Inde sous le simple nom de « Mother » s’en retournait vers le Père. Mère Térésa de Calcutta, petit bout de femme de rien du tout qui, par sa vie offerte, en a transformé tant d’autres.
Quinze ans plus tard, à l’occasion d’un séjour dans « la Cité de la Joie », j'étais à genoux devant la tombe de la Bienheureuse. Je venais volontiers prier en sa compagnie avec d'autres volontaires, avant de rejoindre l'un de ses dispensaires où nous travaillions. Or, chaque matin s'accompagnait du même trouble : le sentiment d'inutilité, d'impuissance au regard de ce que fut sa vie. Consacrer mes pieds nus et mes mains fragiles à la misère humaine ? Hors d'atteinte ! Pire, il m'était impossible de demander à Dieu qu'il m'en donne la force, sans craindre qu'il le fasse vraiment. Alors je priais pour qu'il m’ouvre au moins les yeux sur ma faiblesse et cet orgueil qui m’immobilise. Exiger qu’à l’école des pauvres, je sache m’oublier à leur cause et grandir, un peu, auprès d’eux. Ça oui, je le pouvais. Et chaque matin, la petite mère s’en allait dans son sari blanc à liseré bleu, porter ma piètre prière au Père.
On ne va pas à Calcutta pour sauver le monde. Mais pour se sauver soi-même. Si je vous décrivais ces séances de massages sur un jeune homme aux membres amputés, l’esprit fermé et les yeux sans joie, comprendriez-vous que c’était mon âme qui semblait être pétrie par des mains expertes ? Si je vous racontais mes efforts pour nourrir à la cuillère un vieillard alité, qui vivait alors ses dernières heures, arriverais-je à vous expliquer que c’était bel et bien moi qui m’en trouvais nourri ? Comment dire que l’on grandi aux tâches les plus simples offertes aux hommes les plus pauvres, de la toilette aux coups de balais, à la vaisselle des repas, à la lessive quotidienne… C’est la grande leçon de Mère Térésa : la découverte de la joie du service, en même temps que celle d’un Dieu qui saisit la chance de vous aimer.
Il y a une croix accrochée dans la chapelle de "Mother House", la maison-mère des Missionnaires de la Charité. A sa gauche est écrite la supplique du Christ agonisant : « I thirst ! ». « J'ai soif ». Cette soif n’est pas d'eau mais d'abandon amoureux, de sacrifice aussi. D’esprit brisé. Mère Térésa y voyait « le désir divin infini d'aimer et d'être aimé » : « tant que vous n'écouterez pas Jésus dans le silence de votre cœur, vous ne pourrez pas l'entendre dire "j'ai soif" dans le cœur des pauvres. Vous lui manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous ! » De l’autre côté du crucifix est inscrite la réponse offerte par les sœurs : « j'étanche sa soif ».
On ne va pas à Calcutta pour sauver le monde, mais pour s’agenouiller au pied de la Croix. La meilleure place pour contempler le cœur de l'humanité. Humblement, à la mesure de nos yeux imparfaits, jusqu’à voir Dieu assoiffé dans ce jeune homme amputé ou ce vieillard au seuil de la mort - « le Christ dans un déguisement désolant ». Et lui donner à boire.
« Nous savons bien que ce que nous faisons n'est qu'une goutte dans l'océan, disait la Bienheureuse lors de la réception du prix Nobel de la paix, en 1979. Mais si cette goutte n'était pas dans l'océan, elle manquerait ! » Juste une goutte d’eau, petite et essentielle, pour étancher toutes les soifs.
vendredi 10 août 2012
Le complexe d’Obélix
« Ils sont fous ces Romains ! » La phrase est célèbre, presque une fierté nationale, tout comme celui qui en a fait sa devise, Obélix, fidèle ami d’Astérix et symbole du bon sens naïf. Au fil de leurs aventures, notre ami gaulois décline volontiers la formule aux Belges, Bretons, Helvètes, Indiens ou wisigoths et autres goths… Et à tous ceux, finalement, dont les us et coutumes suscitent son incompréhension. Car aussi brave soit-il, Obélix ne mesure ses découvertes qu’à l’aune de sa seule sphère de connaissance, limitée, somme toute, aux environs d’un petit village armoricain. Une pyramide égyptienne ? « Bah ! Ça ne vaut pas un beau menhir », s’exclame-t-il. Derrière la gentille caricature, Uderzo et Goscinny ont brossé un trait bien caractéristique du "français moyen" : son impossibilité chronique de s’extraire de ses seuls éléments de référence pour recevoir et contempler ce qui lui est étranger.
« Méfiez-vous du complexe d’Obélix », m’enjoignait un ami, alors qu’il m’accueillait pour la première fois sur le sol chilien. Il m’avouait ainsi ses craintes que je ne puisse partager son amour du pays, par manque d’ouverture, ou que le décalage culturel me ferme à ses beautés. Une méfiance toute naturelle face à l'arrogance dont témoignent certains touristes occidentaux, cette tendance à se croire partout chez soi ou, pour le moins, en territoire conquis. Je ne veux pas m’appesantir ici sur la triste réputation que trainent les français en dehors de leurs frontières, mais souligner l’état d’esprit qui convient à tout voyage, pour peu qu’on les considère comme autant d’occasions d’expériences de vie.
En Amérique latine comme ailleurs, en tant qu’invité de passage, il convient de mettre ses codes culturels en veilleuse. Sinon par soif de découverte, au moins par respect de l’autre. Si je traine mes brodequins Décathlon du côté des contreforts Himalayens, me serait-il si difficile de les déchausser sans rechigner, avant de visiter un temple bouddhiste ? Le souvenir d’un "bouillon sauvage" à la viande de porc-épic dans une rue de Brazzaville ne réveille pas mes papilles, mais pourrais-je en vouloir aux congolais de ne pas connaître les secrets d’une bonne andouillette de Troyes sauce chaource ? Allons plus loin : peut-on accepter les conditions de vie d’un dispensaire de Calcutta sans se défaire du minimum hygiénique acceptable d’une clinique européenne ? Il faut le souligner, la qualité gastronomique et le degré de civilisation, comme le sous-développement ou la pauvreté, sont des notions bien relatives...
Tout voyage commence par un premier pas. Il est intérieur et consiste à se défaire de ses bagages d’idées préconçues pour élargir ses horizons. Voyager, c’est s’abandonner à l’inconnu, dépasser le choc des cultures pour appréhender un contexte. Ne pas venir en consommateur. Accepter de perdre ses repères, de ne rien connaitre et donc, de ne rien comparer. Simplement de recevoir. En d’autres termes, de redécouvrir la capacité d’émerveillement de l’enfant.
Le complexe d’Obélix dresse ses barrières entre soi et l’inconnu. Etre témoins parmi les hommes implique une acceptation et un respect de l’autre : se soumettre aux traditions locales, parler la langue… Notons ici qu’il y a une différence entre l’admiration béate et l’effort d’acculturation : l’objectif n’est pas de gommer ses différences ou de renier ce que l’on est, mais de chercher à mieux comprendre l’autre en acceptant ses règles. Bref, de l’accueillir comme il est, avec sa culture et ses différences, et non pas comme on voudrait qu’il soit au regard de nos propres critères, forcements réducteurs et décalés.
Ma culture, mes croyances et mon histoire
personnelle peuvent légitimement me pousser à considérer telle ou telle
pratique comme folle et à « faire mon Obélix ». Mais ma
culture, mes croyances et mon histoire personnelle suffisent-elles à englober et
à comprendre la diversité du monde ? Assurément, non. A moi d’accepter
humblement cette impuissance, de la faire mienne et de m’ouvrir à ces vérités
qui me sont étrangères. Pas de potion magique pour entrer dans cette démarche. Juste une disposition d’esprit, un acte de volonté.
lundi 2 juillet 2012
Sous les pas des hommes
« Pierre, tu veux être le pavement et qu’ils te piétinent, (…)tu veux qu’ils aillent où tu guides leurs pieds (…).Tu veux servir leurs pieds qui passent, comme le roc sert les sabots des brebis.Le roc, le pavement d’un temps gigantesque.La croix – le pâturage. »
(Bienheureux Jean-Paul II)
Il s'est allongé à même le sol, devant l’autel. Il repose face contre terre, les mains jointes sous son front. Son souffle est paisible, son esprit tranquille. Le temps lui semble comme suspendu, alors que les noms des saints qui appellent à leur suite s'égrainent en une lente litanie.
Derrière lui l’assemblée, ses chers parents, sa famille, ses amis, tous à coeur ouvert, unis par un lien mystérieux. Il se souvient de son enfance heureuse, de ses courses d'adolescent, du vent dans les peupliers... Il se souvient de ses premiers pas d’hommes, de ses premiers choix aussi, des rires et de ses peines. Il revoit les visages de ceux qui l’ont fait grandir dans la foi, veilleuses jalonnant le chemin tracé pour lui. Ce chemin offert à ses pas, qu’il a librement emprunté, poussé par un appel impérieux.
Heureux est-il, « serviteur inutile » dont la posture dit son abandon total à l’œuvre de Dieu. Voici qu’en ce jour, il sera fait prêtre de l’Eglise catholique. Il n’a peut-être jamais été aussi près du ciel, lui qui est, à cette heure, si près de la terre.
lundi 11 juin 2012
Peer Gynt chemine au Grand Palais
C’est l’histoire d’une vie d’homme, dans ses petites lâchetés et ses grandes folies. C’est le récit des soifs d’aventure, une quête de liberté et de sens : celle de Peer Gynt, héros du conte philosophique imaginé par le norvégien Henrik Ibsen. Une histoire « qui n’est ni exemplaire ni édifiante, qui n’est universelle que par son caractère humble et complexe », commente Eric Ruf, metteur en scène de cette pièce qui s'est joué ce printemps à Paris.
Un départ
Peer Gynt a 20 ans, rêve de gloire et s’ennuie dans son village du fond de la campagne norvégienne. Fantasque, mythomane, querelleur et vantard, il s’attire les foudres de sa mère et les moqueries des villageois. Ayant séduit, puis déshonoré une future mariée le jour de ses noces, il se voit obligé de quitter le pays. Il le fera avec le sourire, direction les montagnes, puis les continents lointains. Solveig, jeune femme pure et timide, qu’il aime et qui l’aime en retour, le laisse partir. Son Peer Gynt à besoin de cheminer. Elle l’attendra, le temps qu’il faudra.
jeudi 31 mai 2012
« Un Dieu donc pas de maître », ou le retour des anarchistes chrétiens
Dans « L’Anarchisme chrétien », publié aux éditions de L’œuvre, Jacques de Guillebon et Falk van Gaver nous emmènent aux sources d’un courant de pensée méconnu, qui pose le Christianisme comme seule réponse possible aux désirs de justice et de vérité des anarchistes. Analyse.
jeudi 24 mai 2012
Amédée veut mourir
Il y a, sur un lit d’hôpital, une carcasse immobile qui enferme Amédée. Amédée à vingt ans. Il est prisonnier d’une pièce carrée et d’un corps qui ne lui répond plus. Quand Amédée hurle, on ne voit que ses yeux qui s’agitent. Quand Amédée bondit, on ne sent que ses doigts se crisper. De tout son être, Amédée hurle et bondit. Ses yeux s’agitent et ses doigts se crispent. Rien de plus.
Inscription à :
Articles (Atom)